Karel Teige
(1900-1951)
Typographie moderne et typographie surréaliste

Karel Teige, Stavba a Báseň,
Umění dnes a zítra 1919-1927, Vaňek a Votava, ed.
Olymp vol. 7-8, Prague, 1927
typographie et couverture par Karel Teige
Précédents
Karel Teige ne pouvait pas ne pas être sensible
aux possibilités offertes par la machine d’imprimerie. Selon
lui, l’imprimerie avait pris la place du musée dans le travail
de divulgation. Ses projets graphiques sont un des aboutissements
de la notion poétiste de faire coïncider l’art et la vie. Teige
formule son credo typographique en 1927 dans son étude « Moderní
typo[1] »
(« La typographie moderne »), la première dans laquelle
il réfléchit sur les tentatives tchèques et européennes de créer
un nouveau style typographique et évalue ses propres expériences
dans ce champ[2]. « Moderní typo » a été publiée dans
le mensuel Typografia où Teige allait sous peu présenter
les idées des constructivistes européens Lásló Moholy-Nagy,
Jan Tschichold et El Lissitzky.

Vesch, Objet, Gegenstand,
nos.1-2. Berlin, 1922,
couverture par El Lissitzky, édité par E. Lissitzky et I. Erhenburg
Alors que les typographes professionnels allaient
critiquer le travail typographique de Teige et de ses amis jusque
dans les années 30, la communauté culturelle tchèque accepta
le style typographique moderne avec une relative tolérance.
Cela est en grande partie le mérite des éditeurs tchèques qui
osaient de

Jules Romains, Obrozené
Městečko, Odeon, Prague, 1928,
illustrations par Adolf Hoffmeister,
couverture conçue par K. Teige
temps en temps offrir à leurs lecteurs des
livres aux couvertures faites par des peintres du cercle du
Devětsil : Otakar Mrkvička, František Muzika,
Adolf Hoffmeister, Jindřich Štyrský, Toyen
et Teige lui-même. Dès 1925, le Devětsil publie ses livres
chez Odeon, dirigé par Jan Fromek. A partir de la fondation
de cette maison d’édition, Teige y travaille en tant qu’auteur,
typographe et traducteur. A la fin de 1931, avant la dissolution
du Devětsil, Odeon aura publié près de 130 livres représentant
le constructivisme tchèque de l’art du livre.
Un certain nombre des principes de base que
Teige non seulement annonça dans ses essais mais aussi mis en
pratique avaient déjà été recommandés (et réalisés) plusieurs
années avant par Karel Dyrynk, figure importante de la typographie
tchèque classique. Dès 1909, celui-ci souligne le besoin d’évaluer
le contenu d’une œuvre et son but et de choisir le type et le
format de façon correspondante, car « chaque détail doit
être résolu selon un seul plan commun ». Selon lui, le
typographe devrait essayer

Vítězslav Nezval,
Falešný Mariáš, Odeon, Prague,
1925,
couverture par Jindřich Štyrský et Toyen, édition
limitée à 1000 exemplaires
« de faire de la forme externe du livre
le miroir de son contenu interne ».[3]
Dyrynk lui-même s’inspirait déjà de l’essai du critique F. X.
Šalda « Kniha jako umělecké dílo »
(« Le livre en tant qu’œuvre d’art »), imprimé dans
Typografia en 1905 où Šalda s’interroge sur les
principes de base de l’unité du contenu du livre avec sa forme.
Puis, il y eut aussi, en 1923, la conférence de Šalda «
Nová krása : její genese a charakter[4] »
(« La nouvelle beauté : sa genèse et son caractère »)
anticipant sur la ligne de développement qui allait dominer
les travaux de l’avant-garde d’entre- guerre : le constructivisme
et le poétisme des années ‘20 et le fonctionnalisme des années
‘30, mouvement qui devaient influencer l’architecture et l’urbanisme
et pénétrer pratiquement toutes les sphères de la culture, y
compris la typographie.

Guillaume Apollinaire Prsy
Tiresiovy, Odeon, Prague, 1926,
couverture et page de titre par K. Teige, avec 4 pages d’illustrations
par Josef Šíma,
édition limitée à 1000 exemplaires
« Moderní typo »
Lorsqu’il écrit « Moderní typo »,
Teige a déjà vécu deux années de collaboration intensive avec
l’Odeon de Fromek (avec, par exemple, la préparation éditoriale
de la traduction par Jaroslav Seifert des Mamelles de Tirésias
d’Apollinaire). Il a alors acquis une meilleure connaissance
de l’art du livre constructiviste soviétique et de la typographie
élémentaire du Bauhaus que quiconque d’autre en Bohème. Teige
est à la recherche d’un système typographique qui puisse être
utilisé comme langage visible. Le lettres doivent devenir stimulantes
comme un film muet, indépendantes des barrières linguistiques
et, par là, de pouvoir surmonter tout chauvinisme culturel.
Dans « Moderní typo », il évalue son évolution
et désigne de nouvelles possibilités pour la création typographique.
« La typographie et la polygraphie, » écrit-il en
introduction, « sont en de nombreux points contraires aux
idéaux et aux règles de la typographie moderne dont le père
est William Morris ». Les trois grands écueils menaçant
la renaissance de la culture typographique sont pour lui le
décorativisme de l’Art nouveau, le goût de l’archaïsme
dans la conception graphique du livre et le snobisme des collectionneurs ;
la typographie constructiviste doit s’efforcer de les éviter.
Il rejette complètement l’œil de caractère décorativiste de
l’Art nouveau et souligne les principes d’une lisibilité plus
aisée et d’une adéquation entre type et texte, ainsi que l’avait
établi Karel Dyrynk dix-huit ans plus tôt. Teige était bien
conscient de l’influence de la typographie publicitaire qui
a introduit dans la typographie du livre le type Grotesque aux
côtés de quelques types simples et facilement lisibles du XIXe
siècle[5]. Il considère l’œil de caractère Universal Grotesque, dessiné
et soutenu théoriquement par Herbert Bayer, comme approprié
et

Das Bauhaus in Dessau. Lehrplan,
Dessau, Novembre 1925, conçu par Herbert Bayer
va même jusqu’à essayer d’en modifier quatre
lettres en publiant ses résultats dans le magasine ReD[6]. Il fut aussi intéressé par l’idée, en vogue alors, de
n’utiliser que les lettres minuscules pour tous les types, éliminant
les majuscules. Il introduisit l’idée en tant que possibilité
théorique, pour des raisons philologiques et économiques, mais
n’essaya pas de la mettre en pratique[7].

Karel Teige (éd.), ReD,
Odeon, Prague, 1928-1929
couverture et typographie par K. Teige
Teige formula les nécessités d’un type lisible
et simple à travers six principes de la typographie moderne :
1. Se libérer des traditions et des préjugés :
surmonter l’archaïsme et l’académisme et exclure tout décorativisme.
Ne respecter aucune des règles académiques et traditionnelles
qui ne s’appuient pas sur des raisons optiques mais sont seulement
des formules fossilisées (nombre d’or, unité de type).
2. Choisir des types d’un tracé parfait,
aisément lisibles et géométriquement simples, comprendre
l’esprit des différents types, utiliser ces types selon la nature
du texte, contraster le matériel typographique pour souligner
plus fortement le contenu.
3. Comprendre à fond la finalité. Différencier
les différents types de finalité. La publicité, devant être
visible de loin, pose des postulats différents de ceux que pose
le livre scientifique ou le livre de poésie.
4. Equilibrer de façon harmonique la surface
et la disposition des types selon les lois optiques objectives ;
conception claire et organisation géométrique.
5. Utiliser toutes les possibilités mises à
disposition par les nouvelles découvertes techniques (linotype,
machine d’imprimerie photographiques), lier l’image à l’imprimé
en typophotographie.
6. Une étroite collaboration entre l’auteur
du projet graphique et l’imprimeur est souhaitable, tout comme
est nécessaire la collaboration entre l’architecte et l’ingénieur,
le bâtisseur et tous ceux qui participent à la réalisation d’un
immeuble ; une spécialisation et un partage du travail
sont nécessaires, combinés avec un contact des plus étroits
entre les différents participants.
La conclusion de l’étude est faite de notes
sur ses propres œuvres. Il considère que ses couvertures de
livres, avec leurs couleurs marquantes et leurs figures géométriques
de base, où les surfaces orthogonales sont le mieux servies
par des formes orthogonales et où le cercle joue le rôle de
la figure la plus agréable à l’œil[8],
ressemblent à des affiches.
La conception de Teige invite à la comparaison
avec les postulats de 1923 d’El Lissitzky[9].
Les principes du Bauhaus, qui inspirèrent aussi Teige, ont été
formulés en 1925 par les pionniers de la typographie élémentaire
Lásló Moholy-Nagy et Herbert Bayer en collaboration
avec El Lissitzky, Kurt Schwitters et Jan Tschichold. Teige
a un certain nombre de points communs aussi bien avec les conceptions
du Bauhaus qu’avec celles d’El Lissitzky : la fonctionnalité
et l’utilité de chaque nouvel arrangement de texte ou le respect
des lois de l’optique par exemple. Il souligne la

Kurt Schwitters (éd.),
Merz 1. Holland Dada, Hannover, 1923,
conception graphique par Kurt Schwitters
fonction sociale du livre, son utilité, son
usage des progrès techniques et la collaboration de l’artiste
graphique avec les imprimeurs. Ses six commandements représentent
la culmination théorique du développement d’une des branches
de la typographie moderne tchèque des années 20.
Aux début des années 30, Karel Teige écrit
un article au titre caractéristique : « Konstruktivistická
typografie na cestě k nové formě knihy[10] »
(« La typographie constructiviste en route vers une nouvelle
forme du livre »), dans lequel il récapitule son évolution.
En conclusion, il résume ce à quoi le constructivisme s’est
efforcé d’aboutir dans les années 20 et ce que le fonctionnalisme
va pleinement réaliser dans les années 30 : « La typographie
constructiviste, dans son approche de la conception du livre,
pose trois questions : quoi ? – pour qui ? –
pourquoi ? et seule la synthèse des réponses à ces trois
questions représente la réponse à la question – comment ?
»
Dans le sillage des modèles théoriques de
Teige, d’autres membres du Devĕtsil s’essayèrent à la typographie
contemporaine. Le peintre Otakar Mrkvička qui créa avec
Teige une série de couvertures pour Odeon et pour la maison
d’édition Komunistické nakladatelství considérait aussi
la couverture comme une affiche pour le livre, une affiche qui
ne remplirait pas seulement un objectif commercial mais devrait
surtout « faire du spectateur un lecteur, être une expression
synthétique du contenu, suggérer le caractère du livre et organiser
la psyché du spectateur.[11] »

František Halas, Sepie,
Odeon, Prague, 1927
typographie par K. Teige, couverture par Vít Obrtel
Le théoricien Artuš Šerník partit,
lui, de la typographie élémentaire du Bauhaus. Ses idées ne
représentent pas un système cohérent mais précédèrent l’étude
de Teige « Moderní typo » sur les pages de
Typografia de plusieurs mois.[12]
Un autre des collègues du Devětsil, l’architecte, poète
et illustrateur Vít Obrtel, prit une approche plus polémique
vis à vis du modèle typographique de Teige. Dans son commentaire
« Obálková terminologie[13] »
(« Terminologie des couvertures »), il fait une distinction
cocasse en affirmant que, bien qu’ « une couverture constructiviste
du livre n’existe pas », il n’avait pas l’intention de se distancer
des principes de la conception constructiviste du livre en termes
esthétiques mais uniquement de la terminologie de Teige. Obrtel,
esprit créatif totalement différent de celui de Teige, allait
par la suite pousser la critique encore plus loin : deux
ans plus tard, il accusera Teige de plagiat et de manque d’inventivité[14].
De Na vlnách TSF à Zlom
L’œuvre de jeunesse de Teige s’achève en
1925 par la conception du recueil de poèmes Na vlnách
TSF (Sur les ondes de la TSF) de Jaroslav Seifert.
A la différence de Pantomima (Pantomime) de Nezval
qui a plutôt l’apparence rassemblée d’un
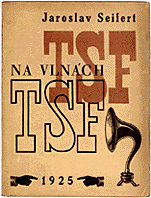
Jaroslav Seifert, Na vlnach
TSF,
Václav Petr, Knihovna Hosta, vol.1, Prague, 1925,
typographie par K. Teige
album de famille du Devĕtsil que celle
d’un livre conventionnel, le recueil de Seifert représente la
première tentative de Teige de prendre en main la totalité du
livre, de la couverture jusqu’au colophon. A ce sujet, Teige
écrit dans « Moderní typo » que l’objectif
de ces deux recueils était de faire en sorte que la typographie
« complète le processus poétique et transpose les poèmes
dans la sphère visuelle ». Pour certains poèmes qui forment
des compositions typographiques indépendantes, Teige utilisa
les conceptions des calligrammes d’Apollinaire et des parolibere
de Marinetti ; pour d’autres, il créa des poèmes-affiches.

Vítězslav Nezval,
Pantomima, Prague, 1924,
couverture et six dessins par Jindřich Štyrský,
typographie par K.Teige, édition limitée à 1000 exemplaires
Teige fut critiqué d’avoir dégradé l’imprimerie
à un cirque dans lequel les imprimeurs s’essoufflent à passer
des majuscules aux minuscules et utilisent n’importe quel caractère
qui leur tombe sous les mains, cependant, à travers les poèmes
typographiques du recueil Na vlnách TSF de Seifert,
il s’agit de l’irruption du poétisme dans la typographie tchèque.
Teige enrichit la conception graphique du livre constructiviste,
élaboré de façon théorique et rationnelle, en changeant les
règles du jeu et en ajoutant de nouveaux matériaux typographiques
et des photomontages. Ces ajouts distinguent les livres de conception
poétiste des livres austères produits par le Bauhaus et des
compositions de l’Hongrois Lájos Kassák, du Hollandais
Piet Zwart et des typographes contemporains polonais.
Teige collabora avec le peintre Mrkvička
à partir du début des années 20. En 1925, ils élaborent ensemble
la conception des couvertures éclairées et pleines de couleurs
de La femme assise et du Poète assassiné d’Apollinaire.
Ces deux projets dépassent la conception des couvertures précédentes
de Teige. Teige le constructiviste fait place ici au style libre
de la peinture de Mrkvička. Les types dessinés prédominent
sur les couvertures.

Guillaume Apollinaire, Sedící
Žena, Odeon Praha, 1925
couverture par K. Teige et O. Mrkvička

Guillaume Apollinaire, Zavražděný
Básník,
Aventinum, Prague, 1925, couverture par K.Teige et O.Mrkvička,
traduction par J. Seifert et M. Šraml, typographie par
K. Teige
La conception que Teige choisit pour les
illustrations constructivistes de Abeceda (Alphabet)
de Nezval est tout autre. « J’essayai de créer une « typophoto »

L’un des 25 photomontages par
K. Teige
à partir de photographies de K. Raspa
de compositions de danse par Milča Mayerová
de nature purement abstraite et poétique, transposant
en poésie graphique ce que Nezval avait mis en poésie verbale
dans ses vers. » Les lettres autant que les images sont
« des poèmes évoquant les signes magiques de l’alphabet[15] ».
La combinaison de photographies des créations de danse de Milča
Mayerová avec des lettres faites de surfaces géométriques
noires et blanches donne un effet artistique cohérent. Le résultat
ne forme pas des illustrations dans le sens classique du terme
car, bien qu’il soit une composante intégrale des quatrains
de Nezval, il pourrait très bien exister indépendamment d’eux.

Konstantin Biebl, Zlom,
Odeon, Prague, 1928,
typographie et couverture par K. Teige.
édition limitée à 1600 exemplaires
Pour l’illustration des recueils de Konstantin
Biebl Zlom (La brisure) et S lodí jež
dověáí čaj a kávu (A bord
du bateau qui importe le thé et le café), Teige utilise
la technique du typomontage. Il combine des surfaces roses et
jaunes avec des lignes noires, des lettres, des symboles et
des signes typographiques, parfois même avec des mots entiers
évoquant une sensation de distance et d’exotisme. Il considérait
ces deux recueils comme des touts unifiés, y compris l’apparence
du colophon.
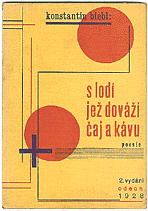
Konstantin Biebl, S lodí
jež dověáí čaj a kávu,
Odeon, Prague, 1928,
typographie, compositions typographiques et couverture par K.
Teige
Chez Odeon, Teige publie l’édition en trois
volumes de Mezinárodní soudobá architektura
(L’Architecture internationale contemporaine) et l’ensemble
d’études en deux volumes Svět, který se směje
(Un monde qui rit) en 1928, puis, en 1931 (mais avec
la

Karel Teige, Svět,
který se směje, Odeon, Prague, 1928
date 1930 sur la couverture), Svět,
který voní (Un monde qui sent bon).
Ces deux derniers titres marquent un tournant dans la typographie
de Teige : alors que la couverture du premier reprend les
compositions en photomontage ainsi que des éléments de l’ère
du poétisme, la couverture du second n’est produite rigoureusement
qu’avec des moyens typographiques. Le texte est réuni de façon
serrée sur le bord inférieur de la couverture, accentué par
un cadre. Emphase sur l’articulation horizontale, condensation
des éléments textuels, l’usage restreint des moyens typographiques
qui régissaient amplement toute la surface des constructions
de couvertures du livre dans les années précédentes pointe à
présent vers la rigueur du fonctionnalisme des années 30.
Les diverses expositions auxquelles Teige
participe, comme par exemple celle intitulée Ring neue Werbegestalter,
dirigée en 1931 par Kurt Schwitters et située au Stedelijk Museum
à Amsterdam, montrent bien combien son travail se distingue
de

Piet Zwart, Het Boek van
PTT (livre des PTT).
Manuel pour les clients des services de téléphone hollandais
Nederlandische Rotogravure, Leiden, 1938
celui des autres graphistes de l’avant-garde.
Teige expose au Ring divers projets graphiques faits
pour ses propres essais et pour les essais d’autres (de V. I.
Lénine notamment), pour des textes littéraires de membres du
Devětsil et d’autrui (de Nezval à Proust, en passant par
Erich Maria Remarque). Il y expose aussi quelques numéros de
la revue ReD ainsi que du papier à lettre aux en-têtes
arrangés. Les projets de Teige étaient entourés de campagnes
publicitaires, entre autres, pour la lingerie intime Bellisana
(Jan Tischold), pour des fils électriques (Piet Zwart), des
voitures (Herbert Mayer) et pour les balances Berkel (Paul Schultema)[16].
Cette différence d’orientation est en grande partie, nous l’avons
déjà dit, dû à la culture éditoriale tchécoslovaque de l’époque.
En plus déjà des maisons d’éditions déjà mentionnées, citons
encore les noms des éditeurs Václav Petr, Otakar Storch-Marien
et Fr. Burian.
La fin de l’existence de la revue ReD
(dont il avait projeté les couvertures et la typographie et
qu’il avait dirigée à partir de 1927) en 1931 clos une phase
de l’histoire de l’avant-garde tchèque d’entre deux guerres,
celle des efforts de la génération du Devětsil pour créer
un style distinct dans toute les sphères de la vie et de l’art.
La nouvelle typographie a développé et, jusqu’à un certain point,
épuisé les conceptions du constructivisme. Celles-ci vont faire
place à celles du fonctionnalisme durant la décade suivante.
Le livre surréaliste
A partir de 1931, année où Teige commence à
travailler en tant qu’artiste indépendant pour la maison d’édition
Fr. Borový, il conçoit près de trente couvertures de
livres. L’apparence des livres publiés par Fr. Borový
connut un changement fondamental au début des années 30, lorsque
la maison d’édition fut radicalement modernisée. C’est alors
que Julius Fürth, directeur de la société Fr. Borový,
engage le

Karel Čapek, R. U.
R., Fr. Borový, Prague, 1935,
13e édition, couverture par František Muzika
peintre et illustrateur František Muzika
ainsi que d’autres artistes graphiques pour une longue collaboration.
La contribution de Teige au profil graphique de la maison
d’édition n’est pas comparable quantitativement
à celle de Muzika, mais les deux anciens collègues du Devětsil
représentent, chacun à leur façon, la typographie moderne, traduisant
les résultats de la recherche de nouvelles formes de l’avant-garde
selon les normes contemporaines. Au début des années 30, Muzika
avait acquis une riche expérience typographique en tant qu’éditeur
graphique dans la maison d’édition tout aussi progressiste Aventinum.
Comme Teige, il a été influencé en ses débuts par la poétique
du Devětsil et devint peu à peu connu comme une autorité
dans le champ de la conception du livre. Tout au long de sa
carrière, il s’est toujours concentré sur l’élément fondamental
de l’architecture du livre : le type[17].
L’art du livre de Teige a été, dans les années
30, quelque peu éclipsé par celui de František Muzika et,
encore plus, par celui de Ladislav Sutnar. C’est en particulier
le travail fait par Sutnar pour la maison d’édition Družstevní
práce à avoir marqué la direction que devait prendre
la typographie fonctionnaliste tchèque. Sutnar, peintre mais
aussi graphiste et journaliste, a été actif en Bohême dans diverses
branches des arts appliqués avant d’émigrer aux Etats-Unis en
1939 (il y travaillera surtout dans le design graphique). Teige
avait beaucoup de respect pour Sutnar malgré leurs positions
esthétiques et idéologiques bien différentes. Il donna même
une conférence élogieuse à l’occasion de l’exposition de Sutnar
de 1934[18].

G. B. Shaw, Obrácení
kapitána Brassbounda, Prague, 1932
couverture et typographie par Ladislav Sutnar,
édition limitée à 1700 copies
Les couvertures que Teige fit pour l’éditeur
Fr. Borový, avec leur composition simple de photomontage
et leur arrangement caractéristique en diagonale, tendent à
être des réminiscences des années 20 et, notamment, de ce qu’il
fit pour les volumes de l’édition populaire de divulgation Knihy
dalekých obzorů. Teige apporta beaucoup d’attention
aux huit livres de Vítězslav Nezval, recueils de poésie
et textes en prose, publiés durant les années 30 chez Fr. Borový.
Chaque volume est organisé comme un tout intégral, peaufiné
jusque dans les moindres détails et conçu dans un

Vítězslav Nezval, Zpáteční
lístek, Fr. Borový, Prague, 1933,
typographie et couverture par Karel Teige
style unifié. Ainsi, dans Zpáteční
lístek (Le billet de retour, 1933), sur chaque
page qui précède le texte, Teige dispose une note bibliographique
dans un rectangle encadré, à chaque fois avec de légères différences,
ces rectangles étant une référence graphique subtile au billet
ferroviaire du titre du livre. Un tournant dans le traitement
du style se fait noter dans les couvertures en photomontage
de 1932 à 1934 – Skleněný havelok (Le
macfarlane de verre, 1931), Zpáteční
lístek (Le billet de retour, 1933) et Sbohem
a Šáteček (Les adieux et le foulard,
1934).
Lorsque nous comparons la typographie de Teige
des années 30 avec celle des autres membres de sa génération,
il est évident que beaucoup de ce qui était de l’expérimentation
d’avant-garde est désormais devenu partie intégrante de la routine
de la conception graphique. Néanmoins, Teige est déjà en train
d’imaginer une nouvelle forme de livre, une nouvelle expression
typographique, traitant les éléments textuels presque avec le
dynamisme de la publicité. Ses couvertures rappellent l’arrangement
frappe l’œil des grandes vitrines des magasins de son temps,
parsemées de par les rues des grandes villes. Cela dit, la force
des conceptions typographiques de Teige ne réduit pas leur lisibilité
ou la clarté de ce qui doit être perçu et lu. Mais ce n’est
qu’après un examen plus approfondi du choix graphique dans son
ensemble que l’on découvre la charpente visuelle qui est suggérée.
Et ce n’est que lorsque la totalité du livre est lue que les
sens cachés de ces nouveaux poèmes visuels deviennent clairs.
Un des intérêts de ces poèmes optiques est aussi qu’en les composant,
pour des couvertures de livres ou pour ses collages, Teige n’était
pas obligé de suivre une représentation narrative conventionnelle.
En 1935, la seconde édition de Pantomima
(Pantomime) est une opportunité pour confronter les vers
poétistes de Nezval avec la structure graphique du

Vítězslav Nezval, Pantomima,
Fr. Borový, Prague, 1935
illustrations par Jindřich Štyrský,
typographie et couverture par Karel Teige
surréalisme. De plus, la nouvelle couverture
rappelle vaguement celle de l’édition originale (1924) par Jindřich
Štyrský. Or, sa conception typographique, presque
sarcastique dans sa retenue, est ravivée de façon propice à
l’intérieur du livre par des collages de petit format dont la
disposition n’est pas laissée au hasard. Une nouvelle conception
du lien entre mot et image apparaît ici : les collages
de Teige ne jouent pas seulement le rôle d’illustrations, ils
fonctionnent de façon individuelle comme un phénomène poétique
de pouvoir égal.

Vítězslav Nezval, Neviditelná
Moskva, Fr. Borový, Prague, 1935,
typographie et couverture par Karel Teige

Vítězslav Nezval, Žena
v množném čísle,
Fr. Borový, Prague, 1936,
photomontages, typographie et couverture par Karel Teige
Neviditelná Moskva (Moscou
invisible) paraît en 1935. Sur sa couverture, on peut noter
pour la première fois le motif d’un espace clos, contenant un
secret caché, à peine suggéré. Žena v množném čísle
(La femme au pluriel, 1936) inclut, aussi pour la première
fois, un simple prisme contenant une image (un collage) qui
apparaît

Vítězslav Nezval, Praha
s prsty deště,
Fr. Borový, Prague, 1936,
typographie, photomontages et couverture par Karel Teige

Vítězslav Nezval, Most,
Fr. Borový, Praha, 1937,
photomontages, typographie et couverture par K. Teige
aussi dans d’autres recueils de Nezval sous
une forme modifiée. Dans les deux recueils de 1936 (le second
étant Praha s prsty deštĕ – Prague aux doigts
de pluie) et dans la seconde édition de Most (Le
pont, 1937), les collages de Teige sont présents sur le
frontispice, sur la page de titre et en tant qu’illustrations
indépendantes. Le lien entre collages et texte est à nouveau
basé sur une relation libre entre contenu et conception typographique,
plutôt que d’être une interprétation littérale du texte. Cette
série de conceptions individualistes des années ’30 est complétée
par la couverture par Teige de la quatrième édition de Básně
noci (Poèmes de la nuit) de Nezval. L’orientation
surréaliste de Teige est visible aussi dans le sombre collage
de la couverture du livre rassemblant trois conférences d’André
Breton et publié à Brno sous le titre Co je surrealismus ?
(Qu’est-ce que le surréalisme ?)

André Breton, Co je Surrealismus
?, Jícha, Brno, 1937,
traduit par V. Nezval, couverture par K. Teige
Le reste de l’œuvre typographique de Teige
nous indique l’ère d’intérêt qui l’occupa le plus durant les
années 30, ainsi que ses activités culturelles et politiques.
Celles-ci sont révélées dans une série de textes qu’il écrit
lui-même ou édite pour la maison d’édition Knihovna Levé fronty.
Ils sont présentés dans des conceptions typographiques sobres
et pures, sans aucune intention graphique, se conformant bien
au caractère de la brochure bon marché destinée aux amis indigents
de la lecture.

Egon Hostovský, Listy
z vyhnanství, Melantrich, Praha, 1946,
couverture et typographie par Karel Teige
Les couvertures épurées des romans d’Egon
Hostovskú ou celles des œuvres complètes de F. X. Šalda,
publiées entre 1947 et 1963, constituent un épilogue paradoxal
au vaste art du livre de Teige. Il produisit aussi d’autres
travaux, de routine bien souvent, pour les maisons d’éditions
Melantrich et Brázda, et qui constituèrent son principal
revenu durant les dernières années de sa vie. Ces dernières
œuvres font preuve d’une certaine résignation artistique de
sa part dans cette sphère.
Ses réalisations, y compris ses travaux typographiques,
furent condamnées à l’oubli dans la Tchécoslovaquie communiste
des années 50. Alors que les écrits de Šalda continuent
de paraître revêtis de la conception typographique de Teige,
son nom n’apparaît plus dans le colophon. Mais cette période
semble avoir instauré une nouvelle signification à la formulation
prophétique de Teige, prononcée deux décades auparavant :
« Créons des produits si précis et si adaptés dans toutes
leurs fonctions à l’utilité sociale qu’aujourd’hui, temps marqué
par la bataille entre la réaction et le progrès, notre œuvre
sera attaquée, abaissée et refusée par la réaction, uniquement
pour devenir une partie indubitable de la propriété culturelle
commune et pour que notre part d’auteurs soit perdue et oubliée
dans son évidence.[19] »
Jean-Gaspard Páleníček
Bibliographie sélective
P. Bregantová, « Poznámky
k Teigeho typografii Čtyřicátých let :
korepsondence s nakladateli », Umění 43, 1995
M. Bohatec, Teige a kniha, Prague,
1965
M. Castagnara Codeluppi ed., Karel Teige,
Architettura, Poesia, Praga 1900-1951, Milan, 1996, et en
particulier : K. Sierman, « La grafica al servizio dell’Utopia »
E. Dluhosch et R. Švácha ed.,
Karel Teige/1900-1951, L’enfant terrible of the czech modernist
avant-garde, Massachusetts Institute of technology, 1999,
et notamment : P. Bregantová, « Typography »
K. Passuth, « Meeting in typography :
Teige and Kassák », Umĕní 43, 1995
Karel Srp ed., Karel Teige 1900-1951,
Pražská Městská Galerie, Prague, 1994,
et en particulier : P. Bregantová, « Teigova koncepce
knihy »
Notes
[1]
K. Teige, « Moderní typo », Typografia
34, n.7-9, 1927
[2]
Les autres étant « Moderní typografie »,
Rozpravy Aventina 7, n.3, 1931 ; « Konstruktivistická
typografie na cestě k nové formě knihy », Typografia
39, n.1, 1932 ; « O fotomontáži »,
Žijeme 2, n.3-4, 1932 ; « Fototypografie.
Užití v moderní typografii », Typografia
40, n.8, 1933 ; « Ladislav Sutnar a nová
typografie », Panorama 12, n.1, 1934 ; « Soumrak
fotomontáže », écrit sous le pseudonyme Karel
Weiss, Typografia 41, 1934
[3]
K. Dyrynk, Krásná kniha jako umělecké
dílo, Prague, 1909
[4]
F. X. Šalda, « Nová krása : její
genese a charakter », Volné směry 7, 1903.
Cf. aussi, pour l’influence de cette conférence sur les travaux
de Teige, V. Effenberger, « K dějinám knižní
architektury. Teige – grafik », Knižní
kultura 1, 1964
[5]
Le peintre et illustrateur František Muzika allait jusqu’à
considérer que la réhabilitation des types du XIXe
siècle restait l’élément principal et permanent de la typographie
constructiviste. Cf. Fr. Muzika, Krásné písmo
ve vývoji latinky, Prague, 1963
[6]
Il s’agit des lettres a, g, k et x,
cf. K. Teige, « Návrh reformy Bayerova písma »,
Red 2, n.8, 1929
[7]
Cf. K. Teige, « Vyřadit velká písmena ? »,
Levá fronta 1, n.1-3, 1930, et K. Teige, « A
+ a = a. K Článku J. Tschicholda », Red
3, 1929-1931
[8]
Au sujet de la valeur symbolique du cercle dans la typographie
poétiste, cf. K. Srp, « Obraz a slovo. Karel Teige a
ikonografie Devětsilu », Ateliér 6, n.8,
1993
[9]
Les huit commandements de Lissitzky, publiés en 1923 dans
l’ouvrage « Topographie der Typographie », Merz
2, n.4, allaient devenir le motto de son étude « Kniha
z hlediska zrakového vjemu. Kniha vizuální »,
Typografia 36, 1929
[10]
K. Teige, « Konstruktivistická typografie na cestě
k nové formě knihy », Typografia 39, n.1,
1932
[11]
O. Mrkvička, « Kniha a plakát », Život
8, 1929
[12]
A. Černík, « Konstruktivistická typografie »,
Typografia 33, 1926
[13]
V. Obrtel, « Obálková terminologie »,
Plán 1, 1929-1930
[14]
V. Ovrtel, « Informace nebo iniciativa ? »,
Rok. Kulturní let«k, octobre 1931. Pour Obrtel,
cf. son ouvrage Vlaštovka, která má
geometrické hnízdo. Projekty a texty, Prague, 1985,
et le catalogue Vít Obrtel (1901-1988). Architektura,
typografie, nábytek, ed. R. Švácha,
Prague, 1992
[15]
K. Teige, « Moderní typo », Typografia
34, n.7-9, 1927
[16]
Cf. Volker Rattenmeyer et al. (eds), Die Amsterdamer Ausstellung
1931, Wiesbaden, 1990
[17]
Au sujet de František Muzika, cf. František Muzika.
Kresby, scénická a knižní tvorba,
F. Šmejkal (éd.), Prague, 1984. Pour la maison
d’édition Fr. Borový, cf. P. Bregantová « Knižní
výtvarníci nakladatelství Fr. Borový »,
in Topičův dům. Nakladatelské příběhy
1883-1949, Prague, 1993
[18]
K. Teige, « Ladislav Sutnar a nová typografie »,
Panorama 12, n.1, 1934
[19]
K. Teige, « Ladislav Sutnar a nová typografie »,
Panorama 12, n.1, 1934
