Biographie de Jean Hus
(1371-1415)
par Daniel S. Larangé
daniel.larange@yahoo.fr
daniel.larange@wanadoo.fr
Né probablement en 1371 dans un village du sud de la Bohême,
Jan Hus poursuit des études universitaires à Prague.
Il y obtient des grades académiques, d'abord à la
faculté des arts libéraux, puis à la faculté
de théologie. Il enseigne lui-même à l'université
et y remplit des fonctions importantes, dont celle de recteur
en 1409-1410. De bonne heure il fait la connaissance de certains
travaux du réformiste John Wyclif (1330-1384), dont il
adopte quelques thèses. Ses premiers écrits, dont
nous ne possédons que quelques fragments, résultent
de son activité universitaire : discours solennels, interprétations
de textes bibliques et autres, œuvres polémiques.
À partir de 1402, année où il devient prédicateur
à la chapelle de Bethléem à Prague, il s'impose
comme porte-parole des tendances réformistes tchèques.
Excellent orateur, il attire autour de lui aussi bien les élites
intellectuelles motivées pour améliorer la situation
de l'Église et les mœurs du clergé que les
citadins aspirant à la justice sociale. Les conflits, jusqu'alors
larvés, éclatent au début du XVe siècle,
et l'université à laquelle Jan Hus est attaché
devient un lieu d'affrontements idéologiques.
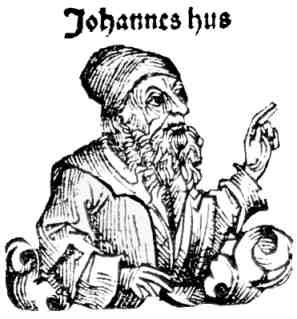
Fondée par Charles IV, cette dernière s'est toujours
avérée cosmopolite. Les enseignants et étudiants
étrangers, principalement allemands, détiennent
trois voix au Conseil universitaire, alors que les Tchèques
ne disposent que d'une voix et se trouvent ainsi représentés
en minorité pour le choix pédagogiques des programmes
et des investissements du financement. Les professeurs allemands
plutôt partisans du thomisme s'opposent aux théologiens
tchèques attirés soit par le nominalisme de Guillaume
d'Occam, soit le réalisme de John Wyclif. Les querelles
idéologiques dégénèrent jusqu'à
l'accusation d'hérésie, par le parti allemand, du
doyen des maîtres tchèques, Stanislav de Znojmo (1360-1414).
Les litiges entre les deux camps jouent un rôle important
dans la conception de la politique internationale menée
par la Bohême. Le parti tchèque en appelle à
la convocation du concile à Pise pour régler le
schisme de la papauté, tandis que le parti allemand s'y
oppose fermement. Le roi Venceslas IV, dont l'approbation est
nécessaire, défend la proposition tchèque
et, pour évincer l'opposition allemande, réforme
le droit de vote à l'université en accordant trois
voix au parti tchèque et une seule au parti allemand. Maîtres
et étudiants allemands quittent alors Prague et s'installent
à Leipzig pour y fonder une université en 1409.
En même temps éclate également un conflit
entre le roi et l'archevêque de Prague, Zbynek Zajic de
Hazembourg. Ce dernier, partisan du pape menacé par le
concile de Pise, finit par s'incliner devant la décision
royale, mais s'en prend au parti réformateur de l'Université,
même s'il en a favorisé les revendications réformatrices.
Il fait brûler les écrits de Wyclif et obtient du
pape l'interdiction de diffuser dans le pays les doctrines du
théologien anglais.

Ces actes sont autant de coups directs portés
contre Jean Hus, alors recteur de l'Université depuis le
17 octobre 1409, , lequel fait l'objet de plusieurs blâmes
ecclésiastiques jusqu'à l'interdit de 1411. Le réformateur
tchèque se défend par des écrits polémiques.
La crise atteint son apogée quand le siège apostolique
autorise la vente des indulgences dans les pays tchèques.
Jean Hus s'y oppose. Le roi, jusqu'alors favorable, se retourne
contre lui et étouffe les manifestations populaires contre
les indulgences. Jean Hus se voit contraint de quitter Prague.
De 1412 à 1414, il vit à la campagne, sous la protection
de quelques hobereaux tchèques, s'adonnant à une
activité d'écrivain et de prédicateur. Ses
meilleures œuvres littéraires datent précisément
de cette période. Toutefois, sa situation reste intenable.
D'un côté, le clergé exige de plus en plus
vigoureusement sa punition exemplaire, de l'autre, Jean Hus lui-même
exige le droit de défendre publiquement ses idées
devant le concile. À la suite de difficiles tractations
diplomatiques, il obtient de l'empereur Sigismond, frère
du roi de Bohême Venceslas IV, un sauf-conduit censé
lui garantir la liberté de mouvement et de parole au concile
de Constance. Le document, et plus encore le comportement de l'empereur,
s'avèrent ambigus. Peu de temps après son arrivée
à Constance, le 28 novembre 1414, Hus se trouve emprisonné
et, au début de juin 1415, sur l'intervention des interlocuteurs
tchèques, il parvient plus ou moins à se défendre
publiquement. En prison, privé de son activité de
prédicateur, il entame une grande correspondance épistolaire
avec ses lecteurs, amis et partisans. Ces lettres représentent
la partie de son œuvre la plus intéressante du point
de vue littéraire.
Le concile n'envisage pas son exécution, conscient des
graves répercutions politiques. L'emprisonnement à
vie lui apparaît comme une alternative. Il exige toutefois
que Jean Hus renie trente points exposés dans ses écrits
ou attribués par les déclarations de témoins.
Le réformateur refuse et rejette même une version
simplifiée de ses " hérésies ",
que ses amis avaient essayé de lui faire accepter. Il est
alors condamné à mort le 6 juillet 1415, brûlé
le même jour sur le bûcher, et ses cendres ont été
répandues dans le Rhin.
